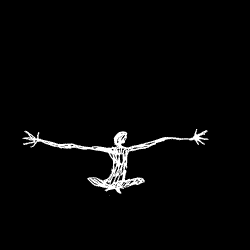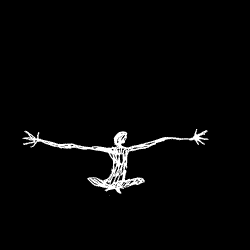MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE D'ANGERS
MAMMIFÈRES ET ÉVOLUTION
Aménagement de deux salles du parcours permanent
Salle des mammifères
La cavalcade / Le cortège des mammifères
Principe général
Au centre de la salle octogonale, une estrade est aménagée, occupée par une cohorte d'animaux, qui fait presque face au visiteur quand il débouche de l'escalier courbe qui monte du rez-de-chaussée. Les spécimens sont nombreux, leur assemblée occupe largement la pièce voûtée.
Le plan de l'estrade est octogonale comme celui de la salle. Son dessin est sobre mais soigné, ce qui fait que cet élément d'agencement s'intègre naturellement à l'architecture du muséum.
Toute la plateforme est légèrement inclinée vers l’avant ; dynamisant ainsi la composition générale, et améliorant l’observation des spécimens, et de leurs appuis au sol. La pente est suffisamment douce (3° environ) pour que la vraisemblance des postures des animaux ne soit pas altérée.
Le parquet de l’estrade
Le motif est un thème important lorsqu’on observe le règne animal (robes, carapaces, plumages, écailles, rayures et taches...). La mise en œuvre d’un parquet sur l’estrade fait indirectement allusion à ce leitmotiv (effet strié), en même temps qu’elle est liée à l’architecture de la salle octogonale.
La finition du parquet est assez brute (pas de traitement ‘marqueterie’ du bois), la fibre est d’aspect naturel (vernis de protection incolore et mat, base aqueuse). L’apparence de la plateforme peut faire penser à un ouvrage temporaire (c’est d’ailleurs le cas, à moyen terme), faisant discrètement allusion au chantier (encore, à moyen terme, le devenir du muséum). La neutralité du bois met les spécimens en valeur, leurs couleurs, leurs motifs, leurs silhouettes.
Éventuellement, la surface de plancher pourrait être teintée (lasurée, c'est-à-dire laissant la fibre du bois apparente) selon un code couleur correspondant aux continents d'origine des espèces.
Disposition des spécimens sur l’estrade
Les animaux sont ordonnés, leurs orientation sont harmonisées, pour gagner en impact visuel. Ils n’occupent pas la plateforme en troupeau anarchique, mais, tous ensemble, suggèrent un mouvement, insufflent un élan à la salle octogonale.
Le cortège des animaux porte ses regards au-delà des murs de la salle, majoritairement vers le côté opposé à la cheminée – certains semblent indiquer les différents parcours du musée.
Mise à distance
Est prévu un dispositif un peu semblable à celui existant aujourd’hui, destiné à empêcher les visiteurs de s’asseoir ou de poser un pied sur le bord de l’estrade.
Bois massif
L’utilisation de bois massif dans cette salle
- d’une part fait écho à l’univers du muséum, installé dans un ancien hôtel particulier : Les boiseries, huisseries, parquets, lambris de toutes sortes entourent le visiteur, et participent beaucoup à l’atmosphère du lieu.
- D’autre part répond aux exigences attendues dans le cadre de projets d’aménagement vertueux : Matériau totalement recyclable/ revalorisable ; Possibilité de s’approvisionner localement, au moins pour certaines essences.
- Enfin, allie la simplicité, la noblesse et l’authenticité d’une matière intimement associée au monde animal.
Éclairage des spécimens
Les animaux sont éclairés depuis les corniches périphériques de la salle. Le précâblage existant sera vérifié, et un peu augmenté, afin de pouvoir équiper davantage de projecteurs ciblés sur l'estrade.
Les lumières pourraient être légèrement teintées, pour obtenir une atmosophère particulière à cette étape du parcours.
====================================
Salle de l'évolution
Faire le lien entre la zoologie et la paléontologie
En accédant à la cage d'escalier du bâtiment 'paléontologie', le visiteur découvre d'abord le buisson de vie, imprimé en très grand format à droite de la porte. Une séquence visuelle se déroule ensuite en triptyque : Deux hautes surfaces noires et grises font face à l'entrée, et une zone très blanche se déploie sur la droite. Chaque partie du triptyque traite d'un aspect de l'évolution des espèces.
La scénographie de cet espace chapitre donc le propos scientifique grâce à des coupes de teintes différentes (une noire, une grise, une blanche).
Vitrines verticales
Dans un creux aménagé dans un renfoncement du mur, sur la gauche, sont présentés les poissons osseux/ cartilagineux. Une vitrine est réalisée à partir d'un capot plexi existant soclé sur un mobilier en medium. Le mobilier de cette partie est noir mat ou satiné.
La vitrine suivante présente les oiseaux et dinosaures, sur fond gris chaud. Toute l'embrasure de la fenêtre haute est occultée, avec un remplissage presque au nu du mur existant. A hauteur de regard, un renfoncement est aménagé, sur le même principe que pour la vitrine noire.
Grâce aux aplats de gris et de noir, et au comblement de l’embrasure de la fenêtre haute, une symétrie s’opère entre les deux vides, pourtant de morphologies bien différentes au départ. Ceci a pour but d’aider le public à lire les contenus comme des parties successives d’un même propos scientifique (chapitrage des informations).
Palier
Enfin, sur la droite, un aménagement léger met en scène les cétacés et ongulés. Les spécimens exposés dans cette partie sont presque comme en liberté, comme s’ils musardaient dans le muséum, et avaient élu domicile dans la cage d’escalier. Cette dimension d’entre-deux convient bien au propos scientifique de cette partie du parcours, entre aparté et sous-partie faisant lien entre les grandes étapes de la visite (zoologie / paléontologie). L’idéal serait, pour appuyer cette idée, d’ajouter un petit spécimen à la série ‘ongulés’, qui se tiendrait en haut du petit escalier.
La girafe est placée sur une estrade de faible hauteur, qui a double utilité : D'une part améliorer la visibilité de ce spécimen (vu en second plan), d'autre part figurer une sorte d'embase au petit escalier en angle, pour lui donner plus d'assise, et l'intégrer plus fermement dans le volume de la salle.
Mise à distance :
Elle est discrète mais efficace, et empêche le visiteur de s'avancer vers le fond du palier. Soit longs tubes acier peints en blanc, reliant l'actuel garde-corps au mur ; Soit barres de bois (rond ou carré aux arêtes chanfreinées), finition blanche également. Le piétement de la vitrine au premier plan de la zone 'ongulés' sert de fixation intermédiaire à ces longues barres, dont la section sera calculée pour obtenir la rigidité nécessaire.
Textes d'exposition dans cette partie
Sur les deux premiers thèmes (objets présentés en vitrines, fonds gris chaud et noir), les textes d’exposition sont en lettres adhésives découpées blanches. Le troisième texte, en négatif, est affichée en caractères noirs sur fond blanc (lettres adhésives découpées également, après préparation du support sur mur existant). La charte de ces textes est la même. Les trois parties sont distinctes mais complémentaires.
Éclairage des spécimens
Dans les deux vitrines verticales, les sources lumineuses sont intégrées au mobilier, et alimentées à partir du circuit existant, qui coure en plinthe sur les murs périphériques. Sources leds directionnelles ou large focale, selon étude lumineuse à réaliser.
Dans la zone 'ongulés', ce sont les rails suspendus existants qui sont mis à contribution, après avoir été réhaussés au maximum. Les spécimens dans cette partie sont donc éclairés d'en haut, à distance. Les objets qui encadrent la porte d'accès à la paléontologie sont aussi éclairés depuis ces rails (mandibules de baleines).
.