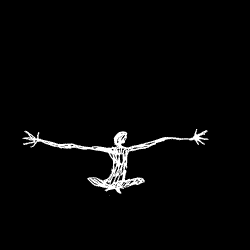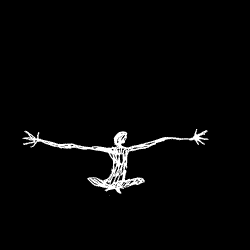CORAN, DES HISTOIRES EUROPÉENNES
Exposition temporaire à la médiathèque Jacques Demy (nantes)
En collaboration avec Ségolène Sauret et Antoine Groborne
PRINCIPES SCÉNOGRAPHIQUES
Le Coran a été importé, étudié et utilisé en Europe depuis des siècles. Traduit, copié, il voyage à travers le temps, l’espace et les idées : que ce soit pour appuyer des polémiques, pour sa beauté poétique ou comme texte de lois, les européens n’ont eu de cesse de l’intégrer à leur culture, par son étude et son analyse.
Généralités sur la forme
Sobriété, modernité et simplicité des volumes, design très architecturé... Les partis pris formels de notre scénographie ancrent le Coran au cœur du monde contemporain, et mettent en valeur l’organisation très structurée du texte coranique, et de la pensée qui y est rattachée. La scénographie évite surtout de jouer la carte du pittoresque, de l’exotisme. Nous pensons que, de la sorte, le Coran et les recherches qui lui sont attachées seront présentées comme partie intégrante de l’Histoire européenne, et non comme éléments étrangers ou extérieurs à une culture de référence.
Les allusions à l’esthétique des écrits coraniques ne sont pas du tout absentes du parcours de visite, mais elles sont stylisées et en proposent une relecture très contemporaine, distanciée mais référencée avec soin. L’idée est de témoigner, tout au long du parcours et pas seulement dans sa partie conclusive, à quel point le Coran est fermement ancré dans la culture européenne ancienne et actuelle, et en est indissociable.
La scénographie est attentive à la matérialité des choses : La plupart des objets présentés montrent l’écriture manuscrite, dans ce qu’elle a de sensuel, autour du geste du copiste – et le thème du coran est lié aussi à la parole, à la psalmodie. Pour cette raison, un soin particulier est porté sur le choix des supports d’exposition et de médiation.
Ainsi que sur les postures adoptées par le public, tout au long de la visite : Comment circule-t-on dans l’exposition ? D’où regarde-t-on ? Notamment pour les postes d’écoute audio, les attitudes proposées au visiteur pour accéder aux documents sonores sont variées et adaptées au contexte.
Les panneaux des textes de salle, très grands, sont autant de ponctuations colorées qui jalonnent le parcours. Chacun a une couleur de fond différente, qui participe à ‘camper le décor’, pour chaque thématique de l’exposition. Pour le reste, au rez-de-chaussée, les interventions colorées sont très ciblées, et très signifiantes selon le thème correspondant. À l’étage, en revanche, la couleur est utilisée avec moins de parcimonie, pour favoriser l’immersion du visiteur dans la dernière étape du parcours.
Réutilisation des vitrines
Toutes les vitrines qui figurent dans notre projet sont issues du stock disponible. Certains caissons ont subi de légères modifications (peinture, démontage du fond), ainsi que certains piétements. Lorsque ces changements engendrent un temps de mise en œuvre trop long, nous pensons plus pertinent de reconstruire quelques petits éléments supplémentaires, qui pourront ensuite s’ajouter au stock disponible, en veillant si possible à la compatibilité des entités entre elles.
*
SYNOPSIS DU PARCOURS
INTRODUCTION
On accède à la salle d’exposition depuis le parvis haut de la médiathèque. L’atmosphère y est lumineuse, aérée, diaphane. Cette – relative – clarté est très diffuse et apaisée. On entre dans un lieu d’érudition et de tolérance.
Le titre de l’exposition est inscrit en grands caractères, européens et arabes, face à l’entrée, sur un format vertical suspendu. Ce format fait partie d’une composition plus étendue, qui se déploie sur toute la longueur de la passerelle qui se trouve en vis-à-vis de l’entrée. Cette composition se présente comme un condensé des composantes de la scénographie du parcours, préambule à la visite : Les voiles translucides suspendus jouent sur des transparences, des superpositions, des effets d’estompe... Métaphoriquement, ces éléments évoquent la multiplicité des points de vue possibles sur un même sujet, s’il est observé à travers des prismes différents. Cette notion nous semble capitale dans le propos scientifique de l’exposition.
Les châssis en tôle perforée font allusion aux moucharabiehs de l’architecture traditionnelle des pays arabes – le fait de les transposer dans un matériau contemporain les replace dans le monde d’aujourd’hui, comme certains architectes le font dans des projets citant l’architecture maure. Dans une perspective non patrimoniale, mais plutôt de relecture, d’actualisation, de réinterprétation.
Esthétiquement, le choix des perforations est important (un vaste catalogue existe). Visuellement, les effets de moirage / d’interférences produits par la superposition de plusieurs surfaces perforées peuvent produire de très belles vibrations, et générer des motifs imprévus et vivants.
Le plafond de la salle d’exposition est estompé, au moyen de légers voiles translucides suspendus. Cet effet de ‘flouté’, en partie haute de la salle, est tenu sur presque tout le parcours de visite. Pour dissimuler la sous-face du plafond qui est très abimée d’une part ; et d’autre part pour évoquer, en creux, la spiritualité liée aux écritures saintes. Dans la zone d’entrée, certains voiles sont disposés en oblique, accentuant l’image d’un lieu qui se dissout, dans ses hauteurs, dans une brume blanche. Sur la gauche en entrant, une vitrine sans piétement est installée contre le mur, légèrement penchée. Quelques ouvrages et les pièces de monnaie y sont exposés. Au centre de la composition graphique de l’entrée, le tableau du scribe lisant un coran est accroché sur l’un des panneaux perforés. Après avoir consulté le texte de salle introductif sur sa droite, le visiteur se rapproche de ce tableau, puis bifurque en direction de la partie 1 du parcours.
PARTIE 1
Contournant le grand panneau du texte introductif, le visiteur accède au premier chapitre du parcours. Un grand format imprimé sur tissu (sur châssis ou contrecollé) est affiché sur un côté de cette première zone. Lui faisant face, trois vitrines sont installées au centre de la salle. L’une d’elle est présentée verticalement, et son fond a été démonté, pour que le visiteur puisse observer le saint suaire sur ses deux côtés, toujours dans ce jeu sur les transparences et les perméabilités.
Les autres ouvrages sont présentés en vitrine. Peu ou pas d’accrochage prévu dans cette première partie. En accédant à cette section du parcours, le visiteur découvre les grands ornements dessinés, issus de numérisations des planches de Jules Bourgoin sur les arts arabes. C’est particulièrement le jeu subtil sur le constructif qui nous intéresse dans ce magnifique travail d’illustration. Ces motifs émaillent le parcours de visite, et évoquent bien le processus d’analyse et de décryptage en œuvre dans les écrits sur le Coran.
PARTIES 2 ET 3
La configuration des deux parties suivantes est assez particulière : Deux alignements de vitrines se font face, séparés par un rang de plaques verticales perforées, formant une longue grille en moucharabieh. On commence par la partie 2, guidé par l’appel visuel que constitue le second grand format de texte de salle, accroché
sur la même cimaise que le précedent.
La surface perforée est organisée selon une trame rigoureuse, mais qui ne se plie pas totalement à l’orthogonalité. Là encore, on se trouve devant une disposition très architecturée, construite avec minutie, mais qui comprend des exceptions, des caprices. Ici le parallélisme entre les parties 2 et 3 est mis en valeur, et pour cause : Les deux approches des études coraniques présentées sont contemporaines l’une de l’autre. Au centre de l’alignement, une vitrine sans fond permet de ‘partager’ un ou plusieurs documents entre les deux thématiques, pour appuyer cette mise en regard.
Cette partie du parcours nous semble importante à scénographier de la sorte : Elle permet d’insister sur la pluralité (la polarisation ?) des points de vue portés sur un même objet d’observation à un moment donné. Les autres parties racontent des périodes historiques distinctes, et, par là même, sont moins propices à ce jeu d’allers- retours. Au point d’articulation entre les thèmes 2 et 3, un long format incurvé occupe le fond de la salle basse. Une grande cartographie des traductions et de leurs déplacements en Europe s’y déploie. Ce format peut comprendre des éléments animés : Un vidéoprojecteur courte focale peut être installé dans la coulisse obtenue, pour travailler en rétroprojection, sur la zone centrale du format.
On ‘lit’ cette grande carte de droite à gauche, en marchant le long du cyclo, qui occupe toute la hauteur de la salle. Tout à gauche du cyclo, le texte de salle de la troisième partie est affiché.
Dans une sémantique de l’espace, ces panneaux de tôle perforée nous intéressent aussi à plusieurs titres : Ils permettent, différemment des voiles translucides, de filtrer le regard graduellement en fonction de la distance à laquelle on se tient d’un objet. Importance du point de vue, encore, dans toute démarche scientifique d’analyse et de commentaire.
Leur porosité visuelle permet, par endroits du parcours, de mettre en scène les liens existants entre certains chapitres du parcours, comme par exemple ceux entre les parties 2 et 3. En tournant autour de ces surfaces, on s’apercevra parfois que les 2 faces en sont différentes - complémentaires l’une de l’autre, mais irréconciliables en même temps.
PARTIE 4
Adossée à la partie 3, une séparation composée de voiles suspendus et de panneaux perforés isole la salle haute de la suite du parcours. On passe cette fine paroi, encadrée sur l’un de ses côtés du texte de salle correspondant, vers le thème 4 de l’exposition.
Cette partie de la salle est basse de plafond, et plus étroite. De plus, ses cimaises et son plafond sont peints de couleur assez sombre, profonde. Au milieu de cette atmosphère épaisse / dense, une rangée de vitrines verticales attend le visiteur. Comme des fantassins lors d’une parade, elles occupent le centre de la scène. L’ambiance est ici plus martiale, plus consistante. Les voiles translucides y sont moins présents, et l’ensemble présente davantage de rudesse.
Un grand tableau est présenté sur la cimaise du fond, et donne un ton pompeux au décor. Les ouvrages à présenter sont répartis dans les vitrines verticales.
La partie sur l’orientalisme est développée un peu plus loin, la où la lumière tamisée provenant de la zone d’entrée de l’exposition au travers des voiles, donne une respiration à l’espace qui mène à l’étage. Dans cette zone est installé l’écran tactile de la médiathèque, accessible sur trois côtés. Y sont présentées des cartographies animées (même fond de carte qu’en parties 2 et 3), ou des documents numérisés non présentés dans l’exposition.
PARTIE 5
Empruntant l’escalier du fond de la salle d’exposition, le visiteur laisse derrière lui les estampes orientales et accède à l’étage. L’ambiance y est radicalement différente. Les couleurs chaleureuses, l’agencement de la salle et son éclairage font penser à l’intérieur d’un café, en tout cas d’un lieu de convivialité, qui invite le visiteur
à s’installer un moment, pour consulter des documents, des ouvrages ou des données en ligne.
Une longue banquette se déroule contre un mur. Son assise est confortable, elle invite à s’assoir un instant, pour consulter des livres ou revues traînant sur une table basse. Le dessin du piétement de la banquette rappelle celui des vitrines. Au-dessus du dossier, une frise au motif contemporain mais renvoyant clairement au monde arabe barre le mur blanc, comme les azulejos ornent certains bâtiments.
Le fond de la petite salle, avec l’accès à sa porte laissé libre, est en partie dissimulé par un voile suspendu, contre lequel la banquette forme un coude. Des sources lumineuses spécifiques sont installées dans cette pièce, et font allusion au café ou au foyer, plus qu’à l’univers muséographique, pour un ensemble visuellement plus chaleureux.
Des pupitres de diffusion audio par conduction osseuse sont disposés dans le café, de manière à susciter plusieurs postures d’écoute ; Accoudé sur un meuble, assis, ou allongé au sol.
PASSERELLE
En quittant le café, pour rejoindre le rez-de-chaussée par le second escalier, le public emprunte la passerelle haute. Sur la cimaise de droite, les planches originales de la bande dessinée sur le Coran sont exposées.
Sur la gauche, des images extraites de la bande dessinée, agrandies, sont imprimées sur quelques voiles suspendus. On n’y a pas prêté attention depuis l’entrée de l’exposition, mais ayant pris de la hauteur, on peut maintenant les observer à loisir. Ces grandes images sont observées en contrejour, la lumière les traverse comme elle le ferait pour un vitrail.
L’appui du garde-corps de la passerelle, élargi pour servir de vitrine, est utilisé comme support pour des dispositifs d’écoute audio par conduction osseuse. Chacun peut s’y accouder, pour écouter un son différent selon l’endroit où l’on se trouve.
Tout en écoutant, on peut contempler ce qui se passe en contrebas : Les voiles éclairés en contrejour révèlent un point de vue inédit sur le parcours scénographique que l’on s’apprête à terminer. Sur l’un des voiles, en premier plan et en guise de ‘panorama’, un agrandissement d’une ou plusieurs case(s) de la bande dessinée imprimé sur textile s’étale.
Depuis ce poste d’observation, on écoute peut-être des extraits du coran chanté, psalmodié. Si le son dispose d’une réverbération naturelle (chant au-dessus d’une ville par exemple), ces sonorités peuvent contribuer à donner du champ à la salle, à en repousser les limites par l’artifice sonore.
*
ÉCO-CONCEPTION DE LA SCÉNOGRAPHIE
Les tôles en acier sont facilement réemployables en fin d’exposition. En effet, ce matériau, bien que demandant une énergie certaine à la fabrication est particulièrement robuste. Il pourra donc être soit gardé par la médiathèque (ou la ville) soit déposé dans une structure du réemploi telle que la Ressourcerie Culturelle.
Les vitrines sont toutes issues du parc existant à la médiathèque. Elles pourront être adaptées en fonction du besoin (piètements, peinture, système de fermeture, conservation des œuvres). Certaines seront soit adaptées de façon à leur apporter une visibilité des 2 côtés soit construites sur la base de l’ancien parc, venant l’augmenter.
La structure de l’espace et les matériaux pré-existants, en bon état, sont conservés ; limitant d’autant l’usage de matériaux neufs.
Les tissus seront issus de sources certifiées afin d’en limiter l’impact et pourront entrer dans le stock de la médiathèque (ou de la ville) ou être déposé dans une structure de réemploi, avec les PV non feu associés.
.