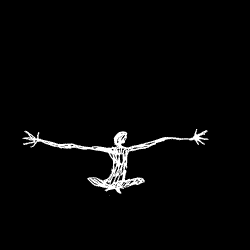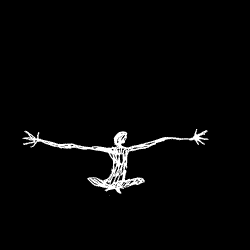INTELLIGENCES, DIFFÉRENTES PAR NATURE
INTELLIGENCE
ÉTYMOLOGIE :
int r (« entre, parmi ») et l g (« ramasser, recueillir, choisir »)
GÉNÉRALITÉS
SCÉNOGRAPHIE
Le dispositif scénographique cherche à rendre manifeste la ‘vision plu- rielle et distribuée de l’intelligence’
mentionnée dans le cahier des charges de l’exposition.
Les contenus détaillés dans le scénario du projet sont denses, nombreux. Le dispositif
s’attache à faire ressentir au public cette profusion d’informations (on ne découvre pas l’ensemble des éléments qu’au fil d’une exploration approfondie
des salles d’exposition) ; en même temps qu’il ménage des vides, des ‘respirations’. Un espace saturé, extrêmement dense et optimisé ne semblerait pas
propice à l’évocation de la vie, et à l’avènement de l’intelligence.
De là l’importance des interstices dans le parcours : Visuellement, et
scénographiquement, il s’y passe aussi des choses. Métaphoriquement, ce dernier aspect souligne l’importance du vide dans le fonctionnement de l’intelligence,
au niveau neuronal et moléculaire.
Le projet mise sur la clarté du parcours, aux circulations faciles et évidentes – mais en offrant au visiteur
une exploration intéressante : chaque partie renferme des sous-parties, qui elles-mêmes, etc. (système fractal, ou structures gigognes). Le travail de
conception graphique ira aussi dans ce sens, engageant le public à débusquer l’information toujours plus avant.
Chaque zone délimitée par le
dispositif est le ‘négatif’ d’une autre : les champs disciplinaires en présence sont parfois imbriqués, même quand les objets de leurs études semblent
très éloignés.
Les manips et les contenus sont des ‘nœuds’ dans un système organisé en réseau. Les liens courent entre les nœuds, les relient,
les enveloppent, créant au passage des micro-architectures.
Les 4 types d’intelligence sont donc bien distincts (« incomparables entre elles »)
mais des liens (conceptuels, par exemple) existent malgré tout qui les relient. Ces liens sont matérialisés par le dispositif scénographique, et
modèlent l’espace du parcours.
Nœuds et connections
Nœuds
Éléments aux lignes légères, le vide tenant une place importante dans leur design.
Prolongations de certaines lignes, qui deviennent des perches ou des mâts, sur lesquels s’accrochent les voiles tendus.
On dirait une forme vivante
de certains composants électroniques myriapodes...
Petits éléments ponctuels ; Outils élémentaires simples, aux lignes sobres et assez répétitives.
Mais qui, combinés de plusieurs façons, génèrent une grande quantité de formes / de micro-architectures. (cf. transistors d’un circuit électronique, ou
connections neuronales, ou objets de programmation). On mise peu sur la sophistication de chaque rouage, plutôt sur leur combinatoire.
Liens
Évocation du réseau > Les voiles tendus matérialisent les liens qui connectent entre eux les nœuds du réseau / les influx qui permettent l’intelligence.
Cette ‘couche’ scénographique a beaucoup plus d’envergure que celle des mobiliers, cette dernière fonctionnant davantage sur un mode parsemé.
Importance de la souplesse du matériau ‘textile’, pour figurer la dimension adaptative des intelligences. La scéno évoque le mouvement, une organisation
en évolution permanente, se ré-inventant sans cesse.
Intelligence : État volatile, versatile...
Aspect fragile / frêle / gracile des tissus
tendus : Volatilité des mécanismes biologiques en jeu – Côté éphémère, instable, évanescent, fugace... des connexions neuronales.
Pourquoi les voiles ?
Les mécanismes en jeu dans le thème de l’intelligence sont incroyablement vivants. Pour rendre compte de cette vie, nous pensons que les moyens ‘conventionnels’
de construction scénographique (larges cimaises en panneaux de bois, mobiliers massifs...) auraient donné du sujet une image trop statique, immuable, inerte.
De là notre choix de recourir à la souplesse et à la sensualité des voiles tendus pour architecturer ce projet. A sujet atypique, matériau hors normes...
Nous pensons que ce choix esthétique et technique permetttra d’obtenir, in fine, un projet ‘différent’, hors les clous, ce qui correspond l’approche scientifique
qui est faite du sujet traité.
*
SYNOPSIS DE LA VISITE
SAS
Un ‘mini-monde’, espace isolé du muséum (secteur minéralogie),
et aussi un peu de l’exposition temporaire, qu’il préfigure pourtant. Comme un endroit dans lequel on regroupe une petite assistance, pour lui raconter
une histoire qui l’emmène ailleurs. Forme courbe, creuse, accueillante, qui invite à l’exploration...
Quittant la salle de minéralogie,
le public accède à l’exposition temporaire. Il pénètre dans un volume creux, délimité par des voles tendus ou suspendus qui forment une sorte de grotte.
Cette micro-architecture l’emmène, instantanément, loin des salles d’exposition permanentes du muséum. Le visiteur se sent convié
à un voyage,
à une exploration. Les parois de ce premier espace sont irrégulières : Certains éléments font saillie. L’ensemble tient plus du bas-relief, ou du décor de théâtre,
que de la fresque en 2D.
C’est sur ce support ‘volumique’ q’une grande vidéo-projection évoque, en résumé, le propos de l’exposition, insistant notamment
sur la représentation contemporaine des intelligences, qui a largement recours à la troisième dimension, et aux représentations ‘en réseau’
ou ‘en buisson’.
Objets vidéos en lévitation, grâce à la technique du mapping.
La configuration du sas permet aux nouveaux arrivants de se poser face à la projection. 1 >
on traverse l’écran, on entre dans le film pour accéder à la suite du parcours
2 > la vidéo est présentée d’un côté du sas, présenté comme un diorama,
dans lequel on n’entre pas. L’accès à l’exposition se fait du côté opposé.
La ritournelle
C’est dans le montage vidéo du sas qu’apparaît pour
première fois une figure qui aura son importance pour tout le reste de la visite : Une animation abstraite, mais reconnaissable à coup sûr, accompagne
le déroulement de ce film d’introduction. Ni animale, ni anthropo- morphe (l’intelligence n’est pas seulement le propre de l’homme),
le montage vidéo
laisse pourtant clairement entendre que c’est elle qui s’adresse au visiteur, et lui enjoint de la suivre plus avant dans l’exposition.
Comme une
ritournelle graphique, sa présence se retrouvera ça et là, ailleurs dans le parcours.
On dirait un influx nerveux, une volute qui bondit avec la
vivacité d’un écureuil... La forme précise de cette ‘mascotte’ n’est pas arrêtée au stade de cette esquisse. Ci-contre, quelques pistes qui pourraient,
peut-être, figurer au cahier des charges du prestataire qui réalisera les médias de l’exposition.
A - PREMIÈRE SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE
1 – Intelligences premières
Quittant le sas, le visiteur découvre le corps de l’exposition.
Le parcours en est plutôt ouvert, de couleurs vives,
aux formes souples et vivantes.
Des mobiliers simples, aux lignes sobres et stylisées, parsèment la salle. Comme les images qui constellaient le sas,
ces meubles, qui sont autant de ponts d’accès au savoir, sont pour la plupart juchés sur piétement métallique. Ils n’ont que peu de prise au sol,
ce qui accentue l’apparente légèreté de l’ensemble.
De larges surfaces colorées ou translucides courent entre ces ‘nœuds’. Elle figurent les liens et
connections qui parcourent le réseau. Ces sur- faces sont constituées de voiles tendus ou suspendus. La souplesse de ce matériau, sa sensualité, évoquent
les processus vivants, adaptatifs, malléables des intelligences.
Intelligences > Souplesse, plasticité, diversité, vie – Décohérence ordonnée –
un buisson, plutôt qu’une arborescence 2D.
Visuellement, l’ensemble est ouvert et fluide. Ceci pour ménager des liens visuels, des perspectives entre
les grandes parties de l’exposition. Pour autant, celles-ci sont très clairement distinctes entre elles (code couleur explicite, notamment), pour ne pas
perdre de vue le caractère incomparable des ‘règnes’ de l’intelligences.
2 – Intelligences végétales
Peu de cloisonnements hauts dans l’exposition,
qui viendraient obstruer la vue. Le visiteur, avant d’accéder à ce deuxième chapitre du parcours en a déjà aperçu certains aspects.
En progressant dans ce
deuxième chapitre du parcours, le visiteur aborde clairement un domaine différent du précédent : La couleur dominante (des mobiliers, des éléments de graphisme,
des voiles) campe une ambiance qui contraste avec celle de la partie 1. Chaque thématique est qualifiée de la sorte, chacune dispose de son propre camaïeu coloré.
Pourtant, on remarque aussi que la forme les mobiliers / supports de diffusion et de maquettes / panneaux graphiques est la même qu’auparavant. Le public commence,
peu à peu, à apprivoiser ces figures, qui sont finalement peu nombreuses. Comme des outils élémentaires, combinés et disposés au gré des besoins pédagogiques.
Du désordre apparent tel qu’on a pu le ressentir en découvrant cette grande salle, commence à émerger un ordre intelligible.
C’est aussi en passant de la première
à la deuxième partie que le visiteur expérimente la structure ‘en réseau’ du parcours d’exposition. Si les 4 thèmes sont clairement délimités dans l’espace, des
perméabilités existent entre eux. Les voiles les liaisonnent ponctuellement / des perspectives et cadrages visuels mettent ça et là les thèmes en relation.
B – SECONDE SALLE D’EXPOSITION TEMPORAIRE
3 – Intelligences humaines
Entre les chapitres 3 et 4 du parcours, le système des voiles tendus est mis à
contribution pour suggérer des liens entre l’intelligence humaine et sa création. L’endroit où les 2 thématiques se touchent sera utilisé de façon judicieuse :
Par exemple, en adossant les intelligences humaines qui sortent de la norme et les prouesses des I.A..
Un voile tendu s’échappe depuis ce dernier secteur de
l’exposition vers le sas de sortie, qui mne au péristyle du Muséum.
4 – Intelligences artificielles
Le parcours ne place pas les intelligences
artificielles en fin de parcours, pour qui explore les secteurs de l’exposition ‘dans l’ordre’. Historiquement, ce sont pourtant ces formes d’intelligences qui
apparaissent le plus récemment. Mais nous pensons que le fait
de ‘conclure’ par l’intelligence humaine insiste sur son statut particulier : En plus d’être
admirable par sa complexité et sa puissance d’abstraction (entre autres), de cette pensée sont issues toutes les connaissances exposées dans le parcours.
Si l’intellect humain n’a pas conçu
les intelligences naturelles, il les a cependant (en partie) comprises, ce qui en fait un cas à part, y compris en regard
des prouesses des IA.